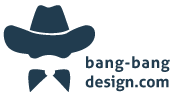J’ai souvent séjourné à Barcelone. J’y allais en train, une seule fois en avion — une erreur. Paris-Barcelone : train de seconde classe, train express, omnibus, train de nuit, wagon fumeur, wagon couchette, fenêtre ouverte, cheveux au vent, chaleur étouffante, marmaille qui braille et les chiens qui puent. Train directe ? Année 2015. L’unification économique de l’Europe a modifié les voies des chemins de fer et supprimé l’étape historique à la gare de Portbou. Le changement de train d’un pays à l’autre, ce bref repos du voyageur humant entre les bouffées de cigarettes, les variations de l’air.
Aux habitués des « citytrips », le transport semble très long, il n’est pourtant que voyage. Mon tout premier voyage en solitaire, sac à dos pesant lourdement aux épaules, trouille au ventre. J’ai toujours aimé le train moins l’inconnu. Il n’y a pourtant aucun exploit. Mais j’étais jeune.
La première fois donc, c’était pour rejoindre Valérie, mon amie d’enfance qui demeurait à Barcelone en tant que fille au père. Habituellement, on se donnait peu de nouvelles mais un soir, j’entendis sa voix au téléphone. Je crus au départ qu’elle avait besoin de moi, qu’elle se sentait seule et que je devenais d’un coup, importante. Fausse impression. Elle ne s’ennuyait pas vraiment, elle espérait simplement voir du monde et surtout partager l’expérience qu’elle vivait. En quelques mots ce fut décidé, elle avait déjà plus ou moins planifié la date et le lieu. A chaque fois que j’y retournais, c’était pour rejoindre Valérie et découvrir ce qu’elle vivait de plus, de mieux qu’à Paris.
J’ai donc souvent séjourné à Barcelone, visité ce que les touristes connaissent et les lieux où seuls les autochtones se réunissent. J’y ai même travaillé — une courte période — alors que je ne sais toujours pas parler espagnol et que mon anglais reste très français. Je connais Barcelone comme aujourd’hui, Paris, qui m’est devenue une ville étrangère. Les rues m’y sont familières, les quartiers des souvenirs, toujours les mêmes repères, mais la vie et les changements du quotidien demeurent inconnus.
À chacune de ces étapes, parenthèses éphémères, je revisitais et redécouvrais sans jamais avancer plus loin que ce qui était immédiat, ce qui s’offrait à la vue, sans trop d’effort.
Personne donc, ni voyageurs ni habitants, collègues ou amis, ne me parla de Can Masdeu : le plus grand potager communautaire de Barcelone. Alors, comment ai-je connu son existence ? Dans un livre, découvert dans une librairie francophone de la ville mais acquis et lu, loin d’elle. Jusqu’à présent, je n’ai visité Can Masdeu qu’entre les pages des « Sentiers de l’utopie1». En voici quelques extraits, prélude à un nouveau voyage.
![]()
Au matin, John prend le volant pour nous mener vers notre prochaine étape, Can Masdeu, qu’il a déjà brièvement visité il y a quelques années. Après vingt minutes de rocade, nous arrivons à Canyelles, un quartier populaire au nord-est de Barcelone. John se gare entre le centre commercial et des HLM tristounets et propose un petit-déjeuner de churros et chocolat. Difficile de refuser cette invitation, mais je m’inquiète d’une arrivée tardive chez nos hôtes. « Pas de problème, c’est à deux minutes », me rassure-t-il. Je suis franchement dubitative ; il a l’air tout à fait sûr de lui, pourtant, j’ai toujours entendu dire qu’il s’agissait d’un projet rural, fondé notamment sur l’agriculture bio. Or on ne peut pas faire plus urbain que ce quartier. Alors que je demande des explications, il joue le mystérieux. Une heure plus tard, nous reprenons le camion et gravissons quelques centaines de mètres derrière le centre commercial, pour découvrir, un chemin barré d’une chaîne à côté de laquelle un panneau annonce : Vall de Can Masdeu. L’écriteau est orné d’un graffiti au pochoir, le fameux poing de la résistance dressé contre toutes les oppressions mais adapté à la réalité du lieu : il brandit une carotte ! Nous y voilà donc, John n’avait pas menti. Nous nous garons et commençons à arpenter un chemin de sable au milieu d’une forêt touffue. Le changement de paysage est pour le moins brusque et j’ai peine à croire que, 100 mètres plus bas, la ville grouille. Au bout de quelques minutes, je vois se découper, sur les hauteurs de la vallée, une immense bâtisse ocre entourée de dizaines de jardins en terrasses. Un beffroi s’élève au-dessus de la maison, la cloche est manquante mais la silhouette d’acier du symbole international des squats — un éclair surmonté d’une flèche traversant un cercle — la remplace fièrement, se détachant sur un ciel bleu azur.
Le site est spectaculaire : nous sommes au milieu d’une vallée verdoyante, un parc naturel préservé (pour le moment) des attaques au bulldozer des promoteurs, surplombant un paysage de gratte-ciel dont les façades de verre miroitent au soleil et se détachent sur la mer scintillant au loin. […]
Le déjeuner est servi sur le patio, à l’ombre d’un immense figuier, dans la douce chaleur de la fin d’été. L’ambiance est conviviale, joyeuse, détendue. Autour de la table, chacun prend son temps, discute des travaux effectués le matin, de ceux à finir l’après-midi.
Le bâtiment dont le groupe assure ainsi l’entretien est une ancienne léproserie abandonnée depuis plus de cinquante ans et entourée d’anciens jardins en terrasses, qui permettaient à la colonie de lépreux de vivre en quasi-autarcie. À sa découverte, en 2001, une dizaine d’activistes catalans et européens décidèrent de mettre un terme à la lente déréliction du lieu en en prenant possession. La plupart d’entre eux étaient déjà des squatteurs expérimentés, considérant l’occupation de logements inoccupés comme un acte politique et une solution pratique au problème épineux du logement dans la capitale catalane. Comme nous l’explique Kike, un jeune Andalou ayant rejoint Can Masdeu cinq ans auparavant : « À Barcelone, ça se passe comme dans la plupart des autres mégalopoles européennes : la spéculation immobilière y est féroce, les coûts de l’immobilier et de la vie sont en spirale ascendante, et les loyers de plus en plus inabordables. Il y a environ 300 000 appartements vides à Barcelone et plus de 3 000 personnes sans domicile fixe. Les politiciens trouvent peut-être cela normal, ou tout du moins inévitable, mais nous, non. »
Entre 2001 et 2005, le prix des vente moyen d’un logement barcelonais a augmenté d’environ 80 % tandis que les salaires ont, selon l’OCDE, globalement baissé depuis les années 1990.
La paupérisation ne cesse donc de se développer et le cercle vicieux qui jette chaque jour davantage de personnes à la rue ne fait qu’empirer. Squatter devient alors une façon d’articuler une résistance en actes contre l’inaccessibilité du logement et de la terre, contre la propriété privée érigée en une valeur si primordiale qu’elle justifie les pires iniquités. Occuper un bâtiment vide et en faire un logis, c’est reprendre le contrôle sur sa propre vie, une façon de sortir du piège de la pauvreté sans rien demander à personne. C’est faire justice soi-même.
Can Masdeu est aussi, de fait, la concrétisation d’une rébellion contre la privatisation des espaces publics qui s’étend comme un cancer. « Barcelone est de plus en plus privatisée et contrôlée, continue Kike en nous servant un café de fin de repas. C’est un phénomène qui a commencé avec les JO en 1992. Le but était de transformer cette ville industrielle et ouvrière, où les mouvements sociaux étaient très forts, en ville « culturelle », aseptisée politiquement. » Un processus de nivellement social par lequel la culture ouvrière est progressivement chassée par la « bobo-isation » et où les quartiers pauvres sont transformés par les boutiques et les cafés à la mode. Ce phénomène a été ironiquement nommé « pacification par le cappuccino2» par la sociologue américaine Sharon Zukin, pour indiquer le parallèle inévitable entre privatisation des espaces et musellement politique qui, de New York à Londres, en passant par Paris ou Berlin, semble n’épargner aucune « capitale culturelle ».
Extrait page 127 à 130 : Les sentiers de l’utopie, un livre-film d’Isabelle Fremeaux et John Jordan, éditions La Découverte, Paris, 2011.
Fin de la 1ère partie.
![]()
1- Les sentiers de l’utopie, un livre-film d’Isabelle Fremeaux et John Jordan, éditions La Découverte, Paris, 2011. 2 – Sharon Zukin, The Culture of Cities, Wiley-Blackwell, New York, 1995, p.28.